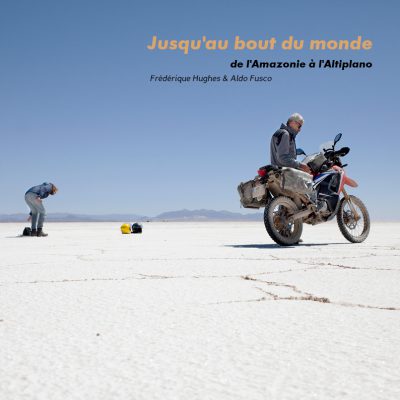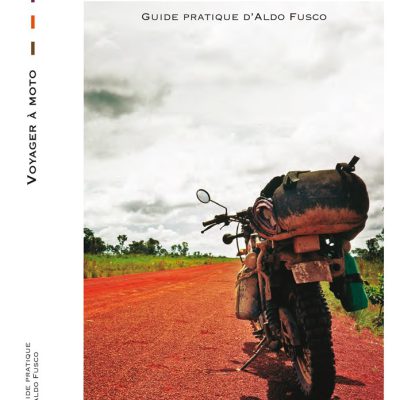Après 3 mois et 6000 km de route, nous venons d’entrer au Panama, notre dernière frontière pour la première partie de ce voyage à travers l’Amérique Centrale, puisque c’est ici que se rejoignent notre précédent voyage et celui-ci. C’est donc un peu notre mi-temps à nous, et désormais il reste le retour vers le Mexique à effectuer, en passant cette fois majoritairement par la côte Pacifique, histoire de voir l’autre facette de cet isthme géant.

Pour l’heure nous n’avons pas encore vu grand chose de ce pays. Hormis le fameux canal que nous avons survolé par le « pont des Amériques », avant d’entrer en ville. On nous avait dit du bien de Panama City, mais à vrai dire nous on ne s’attendait pas à quelque chose d’exceptionnel. L’immense embouchure du canal est malgré tout impressionnante. La dizaine de cargos au mouillage ressemblent à des jouets tant le site est grand. Mais dès l’entrée en ville, je dois dire que l’état général délabré m’a plutôt surpris. Presque aussi laide que les villes du Honduras, c’est dire ! Mais plus tard, en s’y baladant à pied, nous avons découvert d’autres facettes de cette capitale. Les larges avenues du bord de mer (2×2 voies) sont encombrées d’un flux ininterrompu de voitures tout en offrant une vue sur le quartier moderne, avec des tours qui n’ont rien à envier à New York.

A l’autre extrémité de la ville, le quartier historique présente un mélange de bâtiment coloniaux bien restaurés, au pieds desquels les boutiques à souvenirs côtoient des galeries d’art ou des restos bien propres, fréquentés par un tourisme haut-de-gamme. Comme je ne suis jamais le dernier à me moquer, je me disais que c’était un peu leur Montmartre à eux ! Et puis, entre ces deux extrêmes, la ville des gens ordinaires semble se débrouiller comme elle peut, dans un décor un peu bousillé (mi-colonial, mi… rien!) mais vivant. Les métiers informels (vendeurs de tickets de loterie, de fruits, de sacs made in China, etc.) y pullulent parmi une population très métissée (latinos, noirs, indiens) croisée dans les rues piétonnes qui font la jonction entre à la vieille ville « restaurée » et le reste. Bon, on n’est pas tombé amoureux. Mais je ne sais pas trop pourquoi car il faut bien reconnaître qu’un certain charme s’en dégage.

Peut-être parce que, sans chercher à le faire, ce cap sud et cette mi-temps dans ce voyage m’ont conduit à faire un bilan de cette première tranche en Amérique Centrale. Car dans l’imaginaire collectif, côté Français, l’Amérique Centrale se résume souvent au Mexique et au Guatemala avec sans doute une légère confusion quant à la liste et l’emplacement des pays qui suivent… D’ailleurs nos compatriotes sont plutôt rares par ici. Mais ce que je n’imaginais pas en revanche, c’est l’importance du tourisme nord-américain. Il faut croire que les liens historiques ont pris une tournure plus politiquement correcte.
Il fut un temps en effet où les USA soutenaient ouvertement les dictatures de cette zone. La puissante United Fruit Company possédait terres et chemin de fer et était le principal employeur de bon nombre de ces « républiques bananières ». Il était alors facile de faire la pluie et le beau temps dans cette partie du monde. Lorsque les syndicats s’en mêlaient, il suffisait d’agiter le spectre du péril communiste pour obtenir une intervention directe de Washington, notamment via la CIA. Bref, une période pas très jolie-jolie pour l’Oncle Sam.

Aujourd’hui, dans n’importe lequel des pays que nous avons traversé, on se fait d’abord interpeller en anglais. Au Mexique, au Nicaragua, au Costa Rica, dans n’importe quel distributeur de billets on peut indifféremment tirer en monnaie locale ou en dollars. Au Salvador, la monnaie officielle est l’USD, au Panama il existe officiellement une monnaie locale (le balboa) qui est à parité avec l’USD mais qui n’est plus imprimée ! C’est donc là aussi le dollar américain qui est d’usage. En fait, quel que soit le pays, il est toujours possible de payer en dollar absolument partout.

Dans un autre registre, à la frontière du Honduras nous avions échangé avec un enseignant guatémaltèque de passage comme nous. De fil en aiguille (je ne sais plus pourquoi, ni comment) il nous disait que la lutte contre le trafic de drogue était, selon lui, une vaste hypocrisie. Dans la mesure où il existe une forte demande aux USA, il faut bien alimenter ce marché, même s’il est illégal !

Et puis, tout près d’ici, commence le Darien Gap. Une zone où la jungle inhabitée reprend la main sur le monde moderne. Réputé infranchissable le « Darien » est dénué de toutes routes. Il n’existe donc aucune voie de communication pour assurer une liaison terrestre entre Panama et Colombie et les voyageurs transcontinentaux passent par voie maritime ou aérienne. Le Darien c’est aussi une zone de non-droit aux mains des cartels de drogues où transitent à pieds (guidés par des passeurs) les plus fauchés des clandestins pour rejoindre la route panaméricaine avec, en ligne de mire, les USA.

L’ensemble des pays qui constituent l’Amérique Centrale sont tous des Etats souverains, mais malgré tout, à travers le tourisme, la monnaie, les voitures ou les camions, les échanges commerciaux et jusque dans les séries et films télévisés, le grand frère reste les USA ! Modèle et Eldorado rêvé pour beaucoup, l’oncle Sam est adulé autant que détesté. Alors je me disais que finalement cette région du globe c’est un peu leur françafrique à eux.